Ridha Boukadida est une figure d’extrême importance pour le théâtre tunisien. Son nom est essentiel quand on parle d’activités tant sur la scène soit qu’en dehors, entendant par ça la littérature sur le théâtre et l’engagement pour la défense des droits des acteurs. Il a en fait rédigé sa thèse auprès de l’Université de Nanterre Paris X en traitant pour la première fois le théâtre tunisien comme un sujet de recherche.
Pendant ses 35 ans d’enseignement à l’Institut Supérieur des Arts Dramatiques de Tunis (ISAD), il a formé la plupart des acteurs aujourd’hui connus en Tunisie, entre autres Nour Zrafi, Hichem El Fekih et Rabii Ibrahim: les deux premiers, étant de Sousse, font aussi parti de notre recherche, mais aussi la génération de leurs pères.

Nous l’avons rencontré dans sa ville natale, Kalaa Seghira, à 5 km de Sousse, dans un espace qu’il gère avec d’autres personnalités du lieu, « La mémoire pour les traditions locales[1] », pour parler de son expérience mais surtout de l’état légal de l’art du théâtre en Tunisie.
Quand on lui demande de décrire la situation présente de l’art en Tunisie, il part du général et nous répond que le problème principal est le temps et sa notion. Il nous explique que l’Orient, à la différence de l’Occident, n’a pas de calendrier précis, et en Tunisie aussi les dates sont souvent confondues: «…on ne sait même pas quand termine le Ramadan, il faut que l’imam regarde la lune avec un télescope, fabriqué en Occident naturellement !» dit-il ironiquement. C’est pour ça, pense-t-il, que l’Orient est tout le temps en attente, « inchallah », et cette mentalité se maintient dans tout type de décision.
Un autre problème, qui selon lui explique l’avancement trop lent du monde arabe, est la différence entre la Renaissance en Occident et en Orient. Boukadida raconte que c’est à la fin du XIX e siècle que les Arabes commencent à se demander « Pourquoi l’Occident est plus fort ? », question due aussi au choc de la chute de l’Empire Ottoman. Après cette réflexion, explique Boukadida, ce que le monde arabe a décidé de retenir du monde occidental, ce sont seulement les techniques et les technologies et « pas la mentalité, pas la liberté, pas la mixité, pas la démocratie ! », puisque tout cela fait partie de l’idéologie occidentale et n’est pas ‘arabe’. Il définit en fait la Renaissance arabe comme une « renaissance brisée : on voit notre avenir mais en Occident, qui contient aussi notre passé, donc on se retrouve bloqués des deux côtés ».
Telle serait donc, selon lui, la deuxième raison pour laquelle le monde arabe n’avance pas: sa dépendance de l’Occident, sa constante situation de débiteur qui le porte à « ne pouvoir rien seul ». Il définit tout cela avec les mots de néocolonialisme et nouvel impérialisme. Boukadida cite ici Samir Amin, chercheur égyptien qui définit le mouvement social et économique du monde arabe comme croissance plutôt que comme développement, puisque justement il ne s’agit pas de cela. En se basant sur cette position, Boukadida est tenté de parler de la Tunisie comme d’«une petite province oubliée de l’Occident, un peu comme la Martinique ». Comme le décrit Morgan Corriou , «À la veille de la guerre, Tunis réunit toutes les institutions nécessaires aux pratiques culturelles de la bonne bourgeoisie française de province : un théâtre municipal, un salon de peinture, un musée, une bibliothèque, des sociétés savantes et des revues érudites. Les intellectuels et les artistes français de Tunisie ont, comme le public, les yeux tournés vers la métropole et Paris. La Tunisie n’apparaît donc pas à première vue en position de créateur mais plutôt en position de suiveur. Tunis est vue avant tout comme un relais, un échelon, comme le sont les capitales de province, et la colonie française ne semble pas avoir, à l’origine, véritablement pensé les institutions culturelles mises en place dans un contexte local ; il s’agit simplement de reproduire un cadre de vie français.» Pour une analyse sur le rapport identitaire tunisien avec le colonialisme voir aussi Abdesslem Ben Hamida, « Identité tunisienne et représentation de l’Autre à l’époque coloniale », Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 66 | 2003, mis en ligne le 21 juillet 2005, consulté le 21 juillet 2016.
Mais d’autre part, dans son article intitulé « Les Arabes sont-ils en retard ? », Sadri Khiari exprime son point de vue divergent sur le sujet: « Nous aussi, nous avons une grave maladie. Et je crains qu’avec les défaites successives de la révolution arabe, elle ne soit en train d’empirer. Cette maladie s’appelle l’européocentrisme. Elle procède en particulier de deux idées absolument fallacieuses qui se sont imposées avec la colonisation. D’une part, celle que l’histoire avance et qu’elle avance vers le progrès. D’autre part, que l’histoire avance à partir de l’Europe – l’Occident, plus généralement. Dès lors, les pays qui n’ont pas l’illustre bonheur d’être nés en Europe sont réputés être des pays-looser, des pays-has been, « arriérés », « en retard », voire des pays qui ne sont pas « entrés dans l’histoire ». Notre seule ambition serait donc de rattraper notre retard, d’accéder, en suivant scrupuleusement les étapes par lesquelles sont passés les Etats européens, à la modernité.»
Une autre question qui surgit quand on parle de l’art en Tunisie, selon Boukadida, est : « pourquoi personne n’est content ? ». En fait, toutes les parties en cause semblent déçues, à la fois les artistes, le publique et les politiciens. Il explique ce phénomène comme une question historique qui commence avec la colonisation, continue avec l’impérialisme et aboutit dans la mondialisation, comme tentative d’autonomisation qui finit par être un simple ensemble de copies de quelque chose qui se passe ailleurs. Ce n’est pas que cela, naturellement, qui cause l’insatisfaction à l’égard de l’art en Tunisie. Il nous rappelle aussi l’énorme problème de pauvreté où verse une grande tranche de la population, le manque de moyens de la part aussi des artistes et du pubic confirme une vision négative de l’art, pour laquelle on ne veut plus dégager ni d’argent ni d’efforts pour la mettre en place, pour la vouloir vraiment. La vie d’artiste est donc un effort continu, un travail sans illusions ni résultats probables. Les politiciens, de leur côté, parlent d’autres priorités plus matérielles. Selon Boukadida, ce discours se développe de façon très différente dans des états européens comme l’Italie, et pendant notre rencontre nous partageons nos opinions au sujet. En fait, malgré les nombreuses politiques culturelles de la part de l’Union Européenne, qui soutiennent certainement l’art d’une manière bien plus constructive qu’en Tunisie, la conception de l’art comme « luxe » et comme discours à développer après une stabilité économique reste fondamentalement la même.
Cela dit, Boukadida rappelle justement que le manque d’institutions en Tunisie oblige les artistes à « triturer leurs esprits et à trouver toujours des moyens différents, trop souvent occidentaux (comme par exemple la méthodologie) ». Pour ce qui concerne le théâtre en particulier, précise-t-il, s’il faut critiquer ,il faut le faire des deux côtés : à la fois l’Europe et la Tunisie, mais sans les comparer puisqu’elles ne partagent pas la même histoire ; on critique juste pour comprendre.
En fait, les acteurs tunisiens dans leur pays natal n’obtiennent aucune reconnaissance, car le public applaudit surtout qui a l’expérience de l’étranger : seul qui voyage est considéré comme un homme de théâtre à part entière. Un autre gros problème, affronté aussi dans les entretiens avec les jeunes artistes, est celui de la centralisation des activités dans les capitales. Boukadida en parle au pluriel : l’une est Tunis, la capitale politique, où lui-même a vécu 12 ans en s’en fatigant ; l’autre est la télé, qui en Tunisie fait la différence entre ce qui existe sur la scène culturelle et ce qui n’existe pas (tel est le résultat de 23 ans de politiques de Ben Ali). Par exemple, il nous raconte que les Tunisiens à l’époque n’ont jamais vu l’image de Ben Laden ! En plus, après la révolution, le nombre des chaines télévisées est passé de 2 à 7-8, donc le pouvoir et le rôle de ce moyen a augmenté, avec des effets sur les spectateurs qu’il décrit comme abominables justement parce qu’elle est utilisée comme moyen de maîtrise cérébrale de la population. En vérite, même pour les informations elle n’est pas fiable, lui-même affirme d’en regarder 3-4 et comparer plusieurs chaines permet d’en faire la critique.
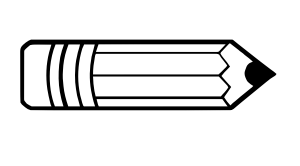
La carte pro
La « carte pro », nom commun de Carte Professionnelle, Boukadida nous explique qu’elle a été introduite en 1986 en application à une loi qui définit qui en Tunisie peut être considéré comme professionnel. La carte est délivrée par une commission qui juge cas par cas selon les titres et l’expérience de chaque personne. Il précise qu’à l’époque, les décideurs réels de cette loi n’étaient même pas diplômés et qu’ils ont fini par sous-évaluer les études et par ignorer l’art. Avant la colonisation, le terme arabe pour art, « fann » indiquait plutôt l’artisanat (on parlait aussi d’art de la cuisine, par exemple). Selon Boukadida, c’est sous les Français que le concept contemporain d’art est arrivé, et puisqu’elle était pratiquée surtout par colonisateurs et Juifs elle a fini par assumer des traits négatifs.
Pour ce qui concerne la commission, est encore aujourd’hui composées de personnes qui travaillent dans l’administration et ont aussi une autre occupation (presque jamais dans le domaine de l’art), et qui donc ne sont probablement pas les plus indiquées pour juger quelle œuvre artistique peut passer au public ou pas.
La Carte Pro principalement :
- donne la possibilité d’inscrire son métier (aussi d’artiste) sur la carte d’identité
- permet de négocier son propre salaire, puisqu’elle atteste une professionnalité
- donne le droit à avoir une petite société de production, qu’elle permet d’officialiser.
Pour obtenir la carte d’acteur, de metteur en scène, de technicien de son ou de lumière, il faut se diplômer à l’ISAD de Tunis ou de Kef, en y déroulant 3 ans d’étude. Elle vient donc délivrée automatiquement à la fin de ce parcours. Pour que la commission la consigne aux amateurs, il faut par contre qu’ils aient participé au moins dans 10 pièces théâtrales comme acteurs principaux et qui ils aient fait des stages et des formations en art dramatique.
L’enseignement ne peut pas y être conjugué, la carte vient en fait enlevée à quiconque l’obtienne et puis se dédie à la carrière de professeur. En même temps, un diplôme non supérieur est suffisant pour enseigner au lycée.
Donc, selon les calculs de Boukadida, si on applique strictement cette loi en Tunisie, on ne comptera rien que 70 professionnels, mais le Ministère a toujours fermé un œil sur le mauvais fonctionnement de ce système, puisque la plupart des artistes qui possèdent une carte professionnelle enseignent aussi, même si ce n’est pas légal. Tout cela est une question d’organisation du métier, mais c’est la volonté politique qui manque, puisque toute la législation est inachevée, et pas seulement dans le champ de l’art, commente Boukadida. En plus, il nous explique que la carte pro est plus facile à obtenir pour les peintres et les musiciens que pour les acteurs, « parce que l’homme de théâtre est exceptionnel ! », plaisante-t-il.
Les musiciens doivent obligatoirement posséder la carte pro pour pouvoir performer (ils doivent pouvoir la montrer pour pouvoir donner un concert). Mais la question n’est pas si grave puisque cette carte leur est délivrée dès qu’ils obtiennent leur diplôme. Ce n’est pas le cas pour les acteurs, ni pour l’art underground qui ne prévoit justement aucun type de diplôme : tous ces artistes se retrouvent sans couverture sociale et souvent à vivre dans la misère. Selon Boukadida, les jeunes ne saisissent pas ce problème; leur enthousiasme le rend imperméables aux conseils et les empêche de bien penser leur futur. Mais pour lui, ce sujet est particulièrement délicat, puisqu’il connait plus de 40 cas d’acteurs qui ont fini leur carrière en mendiant, avec une pension de 160 dinars (environ 70 euros) et sans sécurité sociale. Pourtant, il sait bien qu’au début, c’est assez facile de se lancer dans le métier d’acteur, et qu’il faut peut de chose pour affirmer: « je suis professionnel ». Donc, il se préoccupe à la fois du destin imprévisible des jeunes acteurs qui risquent de ne pas se garantir un statut social, et de la baisse de la qualité artistique que la Tunisie risque de subir si les jeunes ne se fient plus à la formation et aux diplômes.
En somme, dans le domaine du théâtre, on peut compter environs 1000 professionnels, mais le manque d’investissement de l’État empêche le niveau de s’améliorer. Souvent, des amateurs travaillent à la place des professionnels, par exemple dans les séries télévisées, parce qu’ils coûtent moins cher ou parfois même, ils « achètent » leur role tant il aspirent à la notoriété. Boukadida pense qu’en Tunisie, la discrimination porte plutôt sur le contenu du message que sur l’âge de l’artiste: aussi les jeunes ne doivent-ils pas se sentir abandonnés puisque tous les artistes partagent la même condition.
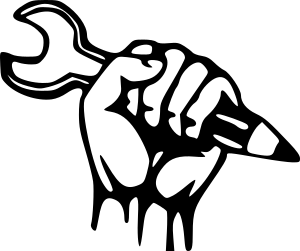
Les syndicats
En Tunisie il existe des syndicats des arts amateurs. Boukadida lui-même y a été actif pendant 4 ans: il y plaidait pour une meilleure législation du métier de l’artiste. En vain.
Sa proposition prévoyait des salaires différenciés :
- le salaire le plus élevé pour les professionnels qui vivent de leur art
- un salaire moins consistant pour qui a aussi un autre métier
- une troisième catégorie de salaire, temporaire, pour les amateurs non diplômés.
Cette solution n’a pas plu surtout aux artistes professionnelles, qui n’ont pas voulu partager salaire et statut avec qui s’engage aussi dans d’autres métiers. Pour défendre cette deuxième catégorie (dont lui-même fait partie) Boukadida rappelle que c’est très dur de vivre de son art : la preuve c’est que, pour survivre, plusieurs acteurs de théâtre se sont résignés à travailler à la télévision.
L’absence de volonté politique n’arrange rien : l’anarchie aboutit seulement à des plaintes désordonnées. Plusieurs problèmes s’accumulent, que l’on ne sait plus comment résoudre.
La seule tentative d’amélioration s’est vérifiée entre 1980 et 1982, quand une politique culturelle avait été mise en place pour encourager la création de nouveaux spectacles et une acculturation du public. Mais au terme des deux ans, le plan a été abandonné au profit du libéralisme.
Dans le passé il existait une politique pour la gestion des Maisons de la Culture présentes dans les grandes villes tunisiennes, qui se distribuaient les spectacles. Actuellement, on assiste à une réduction de deux tiers de cette activité et les Maisons sont presque abandonnées, mal équipées et privées de campagnes publicitaires concernant leur programme.
Dans l’opinion de Boukadida, cette décadence explique peut-être en partie le succès des centres culturel privés auquel on assiste aujourd’hui, mais il préférerait voir l’art rester du domaine public plutôt que de tomber aux mains des privés. Comme il le dit: « C’est aux misérables de faire l’art, pas aux industriels privés! ».
La Fédération Tunisienne des CinéClubs (FTCC) réunit les Cinéclubs tunisiens, qui étaient dans le passé dirigés par la jeunesse de gauche. Le gouvernement les autorisait, les contrôlait et puis les laissait en veille. Maintenant ils sont presque inexistants, il n’y a plus que 9 salles de cinéma dans toute la Tunisie et aucun signal de mouvement.
Quant’à la Fédération des Cinéastes Amateurs (FTCA), l’obligation des cinéastes de passer par un Institut lui a fait perdre son pouvoir et a créé l’anarchie totale. Il est désormais possible de mener de front le cinéma et un autre métier. Mais, par ailleurs, le Gouvernement s’octroie ainsi le pouvoir surveiller les artistes. La Loi 52 contre la consommation de cannabis est détournée comme instrument de censure à l’égard des artistes, de leur entourage et de leur public. Pour couronner cette situation, reste inappliquée la législation existante concernant le monde du cinéma. Les cinéastes se retrouvent donc sans protection.
Pour Boukadida, dans une perspective historique, la Tunisie est en train de revivre les problèmes des années 1965 avec Bourguiba, surtout pour ce qui concerne la confrontation avec l’Occident. Ben Ali, par contre, a réprimé les Frères Musulmans tout en promouvant sa propre manière d’être musulman et au bout de 23 ans de mosquées et d’écoles coraniques il a plongé l’université dans l’anarchie la plus totale, en annulant l’esprit critique : “Ne pensez plus à rien, vous aurez votre diplôme”. Après la révolution, c’est les Islamistes qui ont pris le pouvoir et les mêmes problèmes sont revenus. Naturellement, l’art a été la première victime de ces impositions.
Mais le premier censeur, nous rappelle-t-il, est la population : l’État ne fait que suivre la mentalité dominante.
« Moi, je m’en fous. J’ai commencé rebelle, je finis rebelle. »
Face à ses élèves Boukadida enseigne la vie par l’exemple et le conseil discret.
Très traditionaliste, la société tunisienne est attachée à ce qu’elle connait déjà. Les jeunes eux-mêmes inventent moins qu’ils ne croient. Comme dans toute histoire culturelle, Boukadida entrevoie un progrès dans le mixage de la tradition et de la nouveauté, comme l’illustre le style de Ghoula.
Son témoignage est donc très important pour tous les jeunes qui comptent s’engager dans la carrière d’acteur en Tunisie, pour qu’ils soient conscients des risques qu’ils prennent et des changements que leur activité artistique demande au gouvernement pour être vraiment respectée.

[1] Maintenant, à la retraite, il gère avec d’autres personnalités locales de Kalaa Seghira, sa ville natale, un espace situé dans l’ancien siège du parti au pouvoir, qui depuis 2012 est devenu un café et un noyau de musée pour les traditions locales “La mémoire pour les traditions locales”. L’endroit réunit tout le matériel destiné au tournage d’un film sur ce thème, que des problèmes financiers ont interrompu. Cette association loue donc le local et elle n’a ni fonds ni site web, seulement une page Facebook puisque cela est gratuit.
Ils essaient de sauver des choses qui disparaissent, surtout pour les enfants et les jeunes, pour lesquels ils organisent des visites avec les écoles. La municipalité reste timide aux égards de cette initiative.
BIBLIOGRAPHIE
- BEN HAMIDA, Abdesslem, « Identité tunisienne et représentation de l’Autre à l’époque coloniale », Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 66 | 2003, mis en ligne le 21 juillet 2005, consulté le 21 juillet 2016.
- BOUKADIDA, Ridha, Le théâtre tunisien face à la modernité : la scène dans une société en mutation, 2003.
- BOUKADIDA, Ridha, Contribution à l’évaluation critique du théâtre tunisien.
- CORRIOU, Morgan, Les Français et la vie culturelle en Tunisie durant la Seconde Guerre Mondiale, Thèses de la Sorbonne, 2005 , consulté le 21 juillet 2016.
- KHIARI, Sadri, Les Arabes sont-ils « en retard »?, nawaat.org, consulté le 21 juillet 2016.

3 commentaires Ajoutez le vôtre